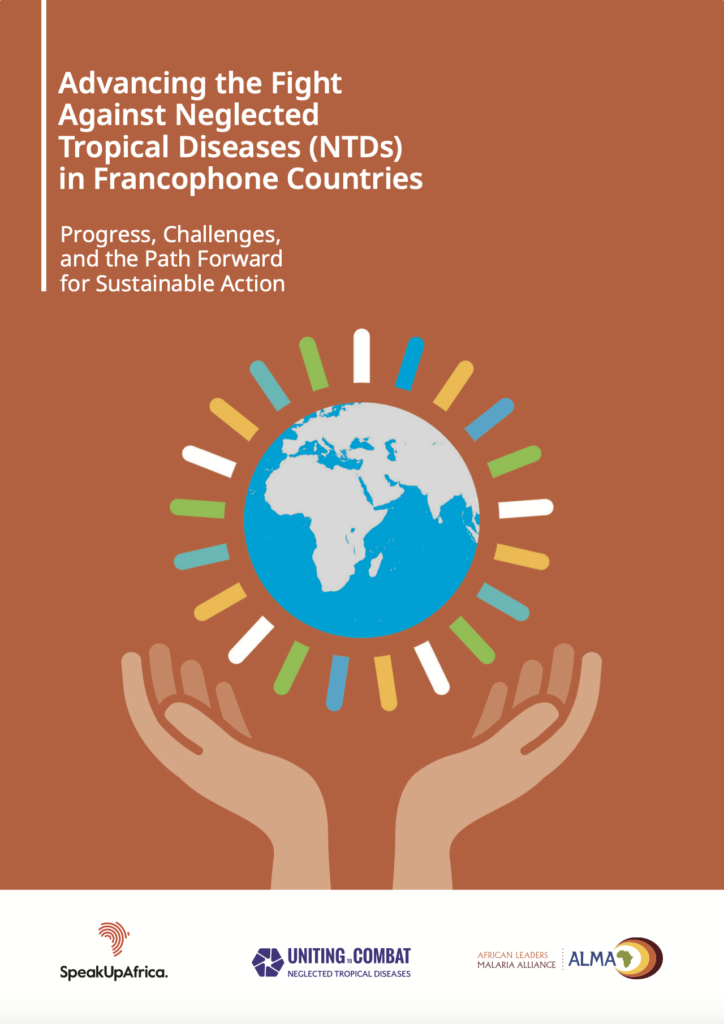Solidarité : Survivre à un nouvel ennemi et vaincre un ennemi familier

Son Excellence, Mme Rebecca Akufo-Addo, Première Dame du Ghana
Le25 avril 2020, je me suis jointe au programme national de lutte contre le paludisme et au service de santé du Ghana pour commémorer la Journée mondiale contre le paludisme. Le thème officiel de cette année était "Zéro paludisme, ça commence avec moi". C'est également le slogan de la campagne que j'ai contribué à lancer il y a un an.
Toute discussion sur les questions de santé publique à l'heure actuelle doit commencer par la reconnaissance de la crise nouvelle et croissante du COVID-19. Mes concitoyens ghanéens et africains craignent à juste titre que nos systèmes de santé ne puissent pas faire face à une propagation incontrôlée du virus. Les effets d'entraînement du COVID-19 sont également potentiellement désastreux pour la santé publique et menacent les progrès réalisés ces 20 dernières années dans la lutte contre le paludisme.
Les épidémies précédentes ont perturbé les services de santé et réduit la capacité des soins de santé à traiter d'autres maladies, telles que le paludisme. L'épidémie d'Ebola de 2014-2016 en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone a entraîné une augmentation massive des maladies et des décès liés au paludisme. On estime que 3,5 millions de cas supplémentaires de paludisme n'ont pas été traités et que 10 900 décès supplémentaires sont imputables au paludisme dans ces trois pays pendant l'épidémie d'Ebola, en raison de la réduction de la couverture des traitements. Nous - individus, communautés, gouvernements, société civile, médias, entreprises du secteur privé et communauté internationale - devons tous faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter que cela ne se reproduise. Nous devons continuer à rendre compte de notre engagement en faveur d'une Afrique sans paludisme, malgré les défis considérables que pose la lutte contre une nouvelle épidémie.
Par l'intermédiaire de la Fondation Infanta pour la prévention du paludisme et de la Fondation Rebecca, ainsi que dans mon rôle de première dame du Ghana, j'ai plaidé en faveur de l'amélioration des résultats en matière de santé pour les groupes vulnérables, qui sont touchés de manière disproportionnée par le paludisme : les pauvres, les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans.
En 2018, les enfants de moins de 5 ans représentaient 67 % (272 000) des 405 000 décès estimés de l'ensemble des décès dus au paludisme dans le monde. Même avant l'épidémie de COVID-19, le paludisme entraînait 10 000 décès maternels chaque année, avec 11 millions de femmes enceintes en Afrique subsaharienne infectées par cette maladie pour la seule année 2018. Le paludisme pendant la grossesse est à l'origine de 11 % des décès de nouveau-nés et de 20 % des mortinaissances.
À mon grand désarroi, entre janvier et mars 2020, sur 95 % des 2 346 677 cas suspects de paludisme testés au Ghana, 1 001 070 ont été confirmés positifs au paludisme. Ce nombre comprenait 21 201 enfants de moins de cinq ans et 28 764 femmes enceintes. Quarante-deux pour cent (42%) des 58 775 admissions dues au paludisme concernaient des enfants de moins de cinq ans. Le pays a enregistré 54 décès dus au paludisme, dont 16 concernaient des enfants de moins de cinq ans. Cela montre que le paludisme n'a pas été mis en quarantaine depuis l'épidémie de COVID-19. Il continue de faire des ravages.
Ces chiffres sont inacceptables. Il est évident que ce sont ces groupes vulnérables qui souffriront le plus. Nous devons renforcer les solutions qui peuvent les protéger.
Des solutions existent pour protéger ces groupes vulnérables. Par exemple, ces décès maternels et néonatals auraient pu être évités grâce à une intervention simple et rentable connue sous le nom de traitement préventif intermittent pour les femmes enceintes (TPIp) à base de sulfurdoxine pyriméthamine (SP), administré lors des visites de soins prénatals de routine et d'un diagnostic rapide et efficace des cas suspects de fièvre et de paludisme.
À la suite de la pandémie de COVID-19, il est possible de perdre de vue la maladie mortelle qu'est le paludisme et les progrès réalisés au fil des ans, tant sur le plan individuel que collectif, pour nous protéger. Nous risquons d'inverser les progrès durement acquis dans la lutte contre le paludisme. Il est très important de poursuivre les efforts déployés par le ministère de la santé et ses partenaires pour faire progresser la prévention, la détection et le traitement du paludisme.
C'est pourquoi, avec les partenaires de la lutte contre le paludisme dans le monde entier, j'appelle à prendre les mesures suivantes à court et à long terme.
Premièrement, les secteurs public et privé doivent investir dans des systèmes de santé solides. C'est sur ces systèmes que nous nous appuierons pour lutter contre les menaces existantes, comme le paludisme, et les nouvelles menaces, comme le COVID-19. Deuxièmement, nous devons continuer à investir dans des interventions vitales contre le paludisme, telles que les moustiquaires, la pulvérisation intradomiciliaire d'insecticide à effet rémanent, la chimioprévention du paludisme saisonnier et le traitement préventif intermittent - des interventions qui sauvent des centaines de milliers de vies chaque année. Troisièmement, nous devons nous efforcer de combler le déficit de financement de 2 milliards de dollars par an pour les interventions de lutte contre le paludisme en augmentant le financement public, ainsi que les mécanismes de financement public-privé innovants tels que les fonds et les fondations pour le paludisme. L'augmentation du financement est essentielle à l'élargissement des solutions qui protégeront les personnes les plus vulnérables de la société. Je sais qu'avec l'arrivée du COVID-19, beaucoup de ressources ont été consacrées à la lutte contre la pandémie, mais nous devrions également poursuivre la lutte contre les maladies connues existantes.
Ces deux dernières années, le mouvement panafricain "Zéro paludisme, ça commence par moi" a contribué à faire en sorte que le paludisme reste une priorité de l'agenda politique, tout en promouvant une approche multisectorielle de la lutte contre le paludisme. Ce n'est que grâce aux efforts conjoints de tous les secteurs de la société que nous pourrons atteindre l'objectif ambitieux de zéro paludisme. Depuis l'approbation de l'ensemble des 55 chefs d'État de l'Union africaine en juillet 2018, Zero Malaria Starts with Me a pris de l'ampleur et, aujourd'hui, 15 pays ont officiellement lancé leur campagne nationale. Au Ghana, nous nous efforçons de renforcer la volonté politique, d'assurer une utilisation efficace des financements existants, d'accroître le soutien du secteur privé et de stimuler l'engagement des médias afin de donner le coup d'envoi de la décennie qui mettra fin au paludisme.
Cette mission ne doit pas être compromise par l'impact du COVID-19. En tant qu'Africains, nous sommes connus pour notre sens de la solidarité. Individuellement et collectivement, nous pouvons tous contribuer à la fois à la survie d'un nouvel ennemi et à la lutte contre un ennemi familier : le paludisme. À l'issue de cette journée mondiale du paludisme, je voudrais inviter tout un chacun à rejoindre le mouvement "Zéro paludisme, ça commence avec moi" et à faire preuve de solidarité avec nos frères et sœurs en cette période d'incertitude accrue.
L'objectif "zéro paludisme" est réalisable si nous faisons tous preuve d'engagement et si nous collaborons mieux. Cela nécessite des efforts individuels et collectifs.
La lutte contre le paludisme commence avec moi, avec vous et avec nous tous.