Novembre Bleu : Et si la génomique devenait l'arme de l'Afrique contre le cancer de la prostate ?
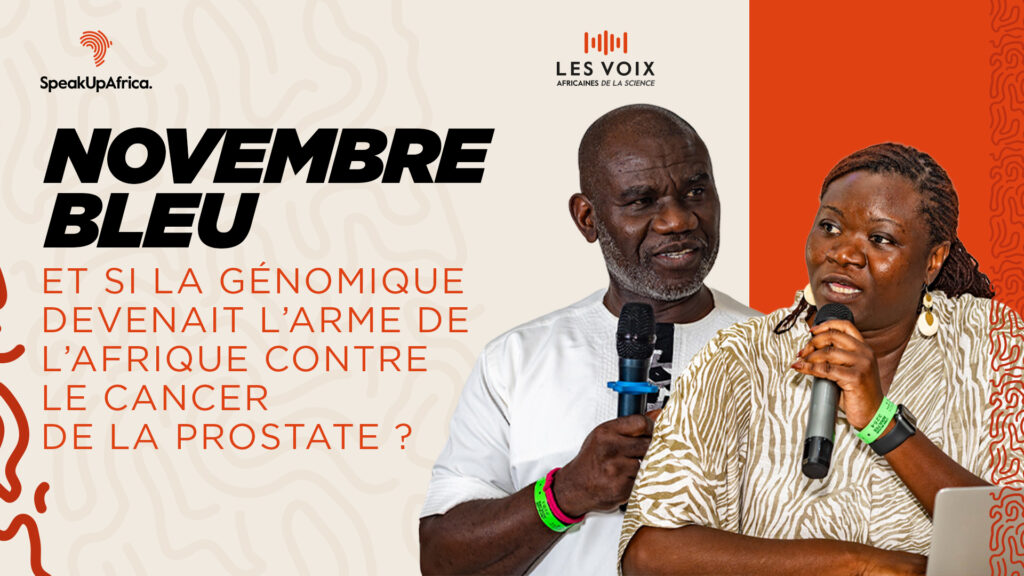
Par Pr. David Tea OKOU, Généticien moléculaire clinique, biologiste moléculaire, chercheur à l'Institut National de Santé Publique de Côte d'Ivoire, consultant scientifique et Fondateur de la fondation YTO et Dr. Safiatou Coulibaly, Coordinatrice du laboratoire Génétique et Cancer, Institut Pasteur de Côte d'Ivoire.
Les cancers représentent un fléau mondial. Bien que l'incidence des cancers soit plus faible en Afrique que dans le reste du monde, la mortalité par cancer est proportionnellement plus élevée en Afrique. La transition épidémiologique que vit l'Afrique en raison de l'urbanisation, de l'environnement et des changements de style de vie contribuent à l'augmentation des cas et des décès. En termes d'incidence et de mortalité, les cancers les plus courants sont le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus et le cancer de la prostate. En plus, avec l'augmentation des risques modifiables du cancer comme le tabagisme, l'alcool et l'obésité, il est prévisible que les cas de cancer augmenteront. A juste titre et sans intervention efficace, l'OMS projette que, d'ici à 2030, la mortalité liée aux cancers dépasserait celle du paludisme, de la tuberculose et du VIH réunis.
Dans ce contexte alarmant, le mois de novembre met un accent particulier sur le cancer de la prostate, une urgence silencieuse dont le poids est considérable car :
- Le cancer de la prostate est aujourd'hui le premier cancer masculin en Afrique.
- Les hommes d'ascendance africaine ont au moins 2 fois plus de risques de développer un cancer de la prostate et 2 à 4 fois plus de risque d'être atteint d'une forme agressive de la maladie, comparé aux non-Africains.
Malgré ces informations, le diagnostic reste souvent tardif en Afrique. Les risques du cancer de la prostate sont dus à une combinaison de facteurs dont la génétique (facteurs non modifiables) et l'environnement (facteurs modifiables). Malheureusement, les spécificités génétiques des africains ne sont pas encore connues et les systèmes de santé en Afrique sont assez fragiles pour gérer un fardeau du cancer qui s'alourdit rapidement dans un environnement où la recherche ne représente pas encore un levier pour une souveraineté sanitaire durable. Bien que la lutte contre les cancers en Afrique soit confrontée à des défis majeurs multiples, ces défis sont surmontables à travers des solutions dont les prémisses existent déjà sur le continent.
Déficit génomique, manque d'infrastructures et sous-financement : les trois grands défis de la lutte contre le cancer en Afrique
Défis génomiques des Africains
La génomique (étude de notre patrimoine génétique) permet maintenant aux chercheurs de connaître les bases génétiques du cancer avec plus de précision, d'identifier les changements dans l'ADN qui soit sont responsables d'un cancer et de choisir des thérapies plus efficaces ou de prévenir certains cancers. Contrairement à ce que nous pensons, un cancer du sein ou de la prostate n'est jamais "le même" d'une personne à l'autre. Même à l'intérieur d'une même tumeur chez la même personne, il existe plusieurs types de cellules cancéreuses, chacune avec des changements d'ADN différents. Cela contribue aux disparités observées, en plus des facteurs environnementaux.
Cette révolution scientifique, fondement de la médecine de précision, ne profite pas encore pleinement aux Africains de la même façon. Le manque criant de données génétiques spécifiques aux Africains et les défis d'application sur le continent freinent le développement de solutions adaptées. En effet, sachant qu'ils possèdent la plus grande diversité génétique au monde, le fait que moins de 2% des Africains participent aux études génomiques est une entrave à l'identification des variants génétiques associés aux risques et à l'agressivité des cancers chez les populations africaines. Le déficit génomique a des conséquences directes sur l'efficacité des traitements. Les marqueurs génétiques et les thérapies développés pour les populations occidentales ne sont pas toujours transposables, rendant la médecine de précision inefficace ou même dangereuse pour les patients africains. Exemple : Au Nigeria et au Ghana, des études ont montré que les cancers du sein chez les femmes jeunes sont souvent plus agressifs et de type triple négatif, avec des variations génétiques moins fréquentes chez les femmes européennes dans certains gènes(BRCA1, BRCA2, TP53, PALB2, etc.)(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38192440/). Dans ce cas, le choix du traitement devient plus difficile sans analyse génomique. Cette sous-représentation des Africains dans les études génomiques se reflète dans les publications dans la recherche, où l'Afrique ne contribue qu'à hauteur de 0,016 % à l'échelle mondiale aux articles en génomique du cancer(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31248437/).
Le manque d'infrastructures, de personnel qualifié et de financement
Les analyses génomiques exigent des centres spécialisés disposant d'infrastructures spécialisées et coûteuses dont les accès restent limités en Afrique. L'indisponibilité continue et l'instabilité des services essentiels comme l'électricité et une connexion internet haut débit est un obstacle majeur au développement de la recherche génomique à grande échelle.
De plus, la recherche génomique est un domaine très spécialisé. Elle nécessite donc un personnel qualifié en génétique humaine et en bioinformatique pour générer et analyser les données génétiques. En Afrique, il existe peu de personnel et de programmes spécialisés en génomique, en dehors de l'Afrique du Sud. D'une manière générale, cela créer une fuite des cerveaux africains qui aggrave les pénuries existantes(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12318875/ et une dépendance par rapport aux spécialistes non-Africains. Exemple : Au Kenya, des hôpitaux ont acquis des machines de séquençage, mais faute de spécialistes, l'analyse des résultats est faite à distance par des équipes internationales(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37646415/).
La recherche génomique nécessite des financements importants, que beaucoup d'institutions africaines ont du mal à réunir. Alors que les pays à revenu élevé consacrent des milliards de dollars à des programmes nationaux de médecine génomique, la majorité des pays africains allouent moins de 1 % de leur PIB à la recherche et au développement biomédical, malgré une hausse notable des cas de cancer.
Par ailleurs, les priorités de recherche nationales restent largement orientées vers les maladies infectieuses comme le VIH, le paludisme ou la tuberculose, reléguant le cancer au second plan. Les chercheurs dépendent donc des financements internationaux qui sont très compétitifs et souvent assortis de contraintes. Au niveau des gouvernements Africains, quand bien même le soutien financier aux infrastructures de recherche est insuffisant, beaucoup peinent déjà à renforcer leurs systèmes de soins primaires.
Ainsi, faute de financement, des projets prometteurs sont abandonnés, et ceux qui subsistent subissent des retards ou des compromis affectant leur qualité.
Une autre réalité existe : la majorité des Africains financent eux-mêmes leurs soins de santé et ce malgré que le coût des tests génétiques et les traitements ciblés demeurent onéreux.
Ainsi, dans un contexte où le cancer représente déjà une charge financière élevée, intégrer les avancées de la génomique dans la pratique clinique constitue un défi majeur.
Pour finir, plutôt que d'envisager la recherche, plusieurs centres ont recours à des laboratoires externes pour certains tests spécialisés, compte tenu des capacités limitées en diagnostics moléculaires locaux(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12043467/).
Construire une réponse africaine : investir, former, coopérer
Malgré les obstacles importants détaillés précédemment, l'Afrique dispose déjà de leviers concrets pour transformer la lutte contre les cancers. Plusieurs pistes existent - certaines bien établies, d'autres émergentes et montrent que des solutions adaptées au contexte africain sont non seulement possibles, mais déjà en marche. Accélérer la recherche en génomique du cancer et améliorer les soins nécessitent une vision stratégique, des infrastructures ciblées et un engagement politique durable
Renforcer les centres de recherche et les mécanismes de financement
Développer une recherche génomique efficace en Afrique passe avant tout par la création de centres spécialisés capables d'héberger des biobanques, des registres fiables et des plateformes techniques de séquençage adaptées. Ces infrastructures permettent non seulement d'élargir l'accès à la recherche, mais aussi de favoriser la participation des populations africaines, aujourd'hui largement sous-représentées.
Le financement demeure un élément déterminant : il conditionne les avancées scientifiques, l'encadrement éthique et la capacité des pays à produire des données fiables. Les gouvernements africains doivent renforcer l'investissement national dans la recherche et le développement, afin de garantir la durabilité des projets et réduire la dépendance à l'égard des financements internationaux.
À court terme, des solutions plus abordables existent, comme l'utilisation de panels de gènes ciblés, moins coûteux que le séquençage complet. Par exemple, en Afrique du Sud, un panel génétique adapté a permis d'identifier rapidement certaines mutations impliquées dans le cancer du sein.
De même, la mutualisation régionale des ressources réduit les coûts d'infrastructure et d'analyse.
Certaines avancées en Afrique du Nord illustrent déjà le potentiel de la génomique : au Maroc et en Tunisie, l'identification de mutations EGFR dans les cancers du poumon a permis d'introduire des thérapies ciblées améliorant significativement la survie.
Former et retenir les compétences africaines en génomique
Pour transformer durablement les systèmes de santé, l'Afrique doit investir dans les compétences humaines. La génomique, en particulier, étant un domaine hautement spécialisé, il est essentiel de développer des programmes de formation dès le secondaire pour susciter des vocations, puis de renforcer les cursus universitaires en génétique, bioinformatique et sciences des données.
Les universités africaines gagneraient à créer ou élargir des programmes consacrés à la génomique, en s'appuyant sur des partenariats avec des institutions régionales et internationales. Ces collaborations peuvent soutenir des chercheurs africains, faciliter leur retour sur le continent et réduire la dépendance à l'égard de l'expertise extérieure.
Les ateliers spécialisés, les formations hybrides et les plateformes en ligne offrent également des alternatives accessibles pour renforcer rapidement les capacités locales.
Impliquer les communautés : un pilier indispensable
L'un des freins majeurs à la recherche génomique réside dans la méconnaissance du public et parfois dans une méfiance liée à des perceptions culturelles. Pour avancer, il est crucial d'engager les communautés de manière proactive, transparente et continue.
Informer sur les objectifs de la génomique, expliquer l'utilisation des échantillons, clarifier les bénéfices individuels et collectifs - tout cela contribue à instaurer la confiance.
Une participation communautaire réelle doit commencer avant le lancement des projets et s'inscrire dans un dialogue durable entre chercheurs, professionnels de santé et populations locales.
Initiatives prometteuses de recherche génomique en Afrique subsaharienne
Loin d'être un terrain vierge, le continent compte déjà plusieurs initiatives structurantes qui posent les bases d'une recherche génomique forte, pertinente et adaptée aux réalités africaines. Ces programmes contribuent à réduire la sous-représentation des Africains dans la recherche mondiale et soutiennent la médecine de précision.
Parmi les initiatives les plus importantes :
- H3 Africa (Human Heredity and Health in Africa): lancé en 2012, ce programme majeur a permis la création de biobanques au Nigéria, en Ouganda et en Afrique du Sud, et a renforcé les compétences africaines dans l'étude des cancers du sein, du col de l'utérus et de la prostate.
- African BioGenome Project (2021) : un projet panafricain visant à combler le déficit de données génomiques, avec plus de 400 scientifiques formés dans 11 pays.
- African Genome Variation Project (AGVP): collecte depuis 2015 des données génétiques auprès de 18 groupes ethnolinguistiques pour soutenir une recherche médicale plus inclusive.
- Initiative africaine de formation en médecine génomique: première initiative de formation à grande échelle destinée aux professionnels de santé du continent.
- Consortium africain du génome du cancer (ACGC): un réseau collaboratif dédié aux caractéristiques génomiques des cancers en Afrique.
- Transatlantic Prostate Cancer Consortium (CAPTC): actif depuis 2005, il étudie les facteurs génétiques et environnementaux du cancer de la prostate chez les hommes d'ascendance africaine, révélant l'importance d'inclure ces populations dans les études pour développer des traitements personnalisés.
Un avenir possible : l'urgence d'agir sans céder au fatalisme
Les progrès déjà réalisés prouvent que le continent peut devenir un acteur majeur de l'innovation mondiale en cancérologie. Mais cela exige une mobilisation sans précédent : gouvernements, instituts de recherche, secteur privé, société civile, médias, chacun a un rôle déterminant à jouer.
En unissant leurs forces et en investissant massivement dans la recherche et développement pour le cancer, les pays africains peuvent réduire le fardeau du cancer, combler les retards en génomique et bâtir une véritable souveraineté scientifique. L'enjeu dépasse la santé : il touche à la dignité, à l'autonomie et au leadership du continent.
Cette année, il est essentiel que Novembre Bleu soit l'occasion de rappeler que l'Afrique peut transformer la crise silencieuse du cancer en un tournant historique.
Encore faut-il que les décideurs politiques, ainsi que les parties prenantes agissent maintenant, avec lucidité, détermination et ambition.











